Lait noir ou Voyage scolaire à Auschwitz
de Holger Schober
Traduit de l'allemand par Laurent Muhleisen
Avec le soutien de la MAV
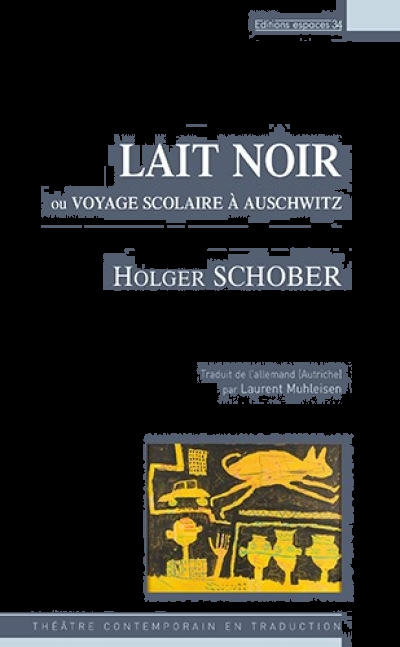
Écriture
- Pays d'origine : Autriche
- Titre original : Schwarze Milch oder Klassenfahrt nach Auschwitz
- Date d'écriture : 2011
- Date de traduction : 2015
La pièce
- Genre : Comédie dramatique sur fond historique
- Nombre d'actes et de scènes : 12 scènes
- Décors : La scène, un grenier, une cuisine, un commissariat de police.
- Nombre de personnages :
- 4 au total
- 2 homme(s)
- 2 femme(s)
- Les deux femmes peuvent être jouées par la même actrice
- Durée approximative : 75 mn
- Création :
- Période : mars 2011
- Lieu : Comedia Junges Theater de Cologne
- Domaine : protégé
Édition
- Edité par : Espaces 34
- Prix : 14.00 €
- ISBN : 978-2-84705-170-4
- Année de parution : 2018
- 72 pages
Résumé
Thomas, un adolescent délaissé par ses parents et en perte de repères, n’aime les excursions scolaires que pour une raison : les filles s’y laissent plus facilement draguer. Garçon passant assez inaperçu auprès de ses camarades, il est entraîné par son seul ami, un jeune voyou néo-nazi, dans une attaque raciste, puis dans une attaque homophobe. Après plusieurs avertissements de la part de son lycée, auquel il ne prête guère d’attention, on lui propose, en « dernière chance » avant l’exclusion, de participer à un voyage scolaire à Auschwitz. Pour lui, ce nom n’évoque pas grand-chose, sinon le chiffre « abstrait » de six millions de morts, et la Pologne est pour lui un pays de voleurs de voitures. Mais ce qu’il découvre en visitant le camp provoque en lui un tel choc qu’il rejette immédiatement, en bloc, toute son identité allemande. Il brûle son passeport, se sépare de son groupe scolaire et part errer dans les rues d’Oswiecim. Arrêté pour vagabondage, il se retrouve dans un commissariat où Tomasz, un policier désabusé et passablement germanophobe tente de découvrir qui il est. Au fil de l’interrogatoire, le garçon et l’homme vont être amenés à confronter les clichés qu’ils ont sur eux-mêmes et les autres avec la réalité, et apprendre à s’apprécier. Thomas refuse d’abord de parler allemand, de dire qui il est, tandis que Tomasz lui reproche toute la xénophobie des Allemands face aux Polonais. Parallèlement, Isabella, la fille de Tomasz (qui en a assez qu’on la regarde d’un air peiné lorsqu’elle dit qu’elle vit à Oswiecim/Auschwitz, et qui, comme toutes les adolescentes, trouve que la vie est bien pénible, et que son père ne la comprend pas) découvre dans le grenier de la maison familiale le journal d’une jeune fille, Marika, écrit pendant l’hiver 41/42 : ce journal se trouve dans une malle ayant appartenu à sa grand-mère Magdalena, la mère de Tomasz. Marika raconte sa vie de jeune paysanne qui rêve d’une vie meilleure et du grand amour, et qui tombe amoureuse de Peter, un soldat allemand gardien de l’immense camp dont la construction vient d’être achevée, camp destiné aux juifs. Marika est intriguée par la fumée pestilentielle qui se dégage des cheminées du camp, tout en étant persuadée que les juifs qui s’y trouvent y sont bien traités, puisque surveillés par un garçon aussi beau et gentil que Peter. Lorsqu’un jour ce dernier finit par la violer, elle donne naissance à une petite fille, Magdalena, qu’elle confie à ses parents avant de se suicider. Isabella découvre ainsi un lourd secret de famille. Cette Marika, la grand-mère de son père, avait été rayée de la famille ; Tomasz lui-même avait longtemps été persuadé que ses arrière-grands-parents étaient en fait ses grands-parents. Il n’a lui-même jamais voulu que sa fille apprenne cette histoire. Au fil de leur « apprivoisement mutuel », Thomas et Tomasz apprennent cependant à la regarder en face, leur histoire. Thomas se réconcilie avec lui-même, Tomasz également (et avec les Allemands). A la fin de la pièce, ayant un soir de répit avant que le policier n’appelle ses parents, Thomas fait la connaissance d’Isabella, qui attend son père, pour, là-aussi, parler avec lui de leur histoire. Mais auparavant, c’est avec Thomas qu’elle va parler…
Regard du traducteur
Le théâtre de Holger Schober est en prise directe avec les problématiques de son époque. Son écriture est dynamique et s’adresse de façon très concrète au public adolescent. Les situations sont quotidiennes, comme le langage. La construction révèle progressivement, selon un schéma dramaturgique ménageant un fort suspense, le champ du sujet traité. Le titre Lait noir est inspiré d’un poème de Paul Celan, qui se trouve à la fin de la pièce. La pièce a été écrite dans un double contexte : celui du danger de xénophobie et de racisme qui touche non seulement une jeunesse allemande en perte de valeurs, mais toutes les populations européennes qui continuent à penser aux « autres Européens » en fonction de clichés souvent éculés (la pièce parle donc fortement d’un « déficit d’Europe »), et celui du devoir de mémoire, pour une génération pour qui les grands crimes du XXe siècle ne représentent plus qu’un chapitre parmi d’autres de leurs livres d’histoire, dont ils ne savent quelles leçon tirer.


